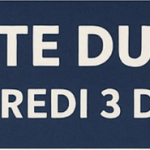Annie Genevard : « La Pac doit être défendue, tout en apportant des évolutions utiles »
À quelques jours de l’annonce de la Commission européenne sur le budget de la prochaine Pac prévue le 16 juillet, la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, pose ses conditions, dans une interview à La France Agricole. Elle évoque également ses préoccupations vis-à-vis de l’accord commercial avec les pays du Mercosur.
Le jour de l’annonce des propositions pour la Pac post-2027 par la Commission approche. Dans quel état d’esprit abordez-vous cette séquence ?
Dans un état d’esprit défensif et offensif à la fois. Défensif car nous voulons défendre une certaine idée de la Pac avec un budget à la hauteur des défis auxquels fait face l’agriculture européenne. Pour une politique emblématique du projet européen depuis soixante ans, déterminante pour la sécurité alimentaire et la souveraineté du continent et sans laquelle il ne peut pas y avoir de pérennité de l’agriculture et donc de notre alimentation. Nous voulons lui conserver son caractère commun car il y a des enjeux auxquels on ne peut répondre qu’en commun. La production alimentaire que nous exportons, elle a nous donne un poids diplomatique éminent dans le concert des nations. Le blé que nous exportons participe à la stabilité du monde.
Mais si mon état d’esprit est également offensif, parce que nous défendons une certaine vision de l’agriculture. Une protection de l’environnement qui doit être intelligemment construite dans une perspective de production. Contrairement à ce que pensent ou proclament ses procureurs, la Pac est une politique d’avenir. Que ce soit la réponse au changement climatique, aux enjeux environnementaux, à l’ouverture aux technologies, à la restauration des sols… Cette intelligence agricole est en réalité le fruit d’une dynamique européenne. Il est très important de pouvoir partager les innovations ; je pense aux épizooties de plus en plus présentes, face auxquelles nous devons pouvoir apporter une réponse européenne en matière de recherche ou de prophylaxie.
J’appelle également à ce que l’Efsa [l’autorité européenne de la sécurité des aliments, NDLR] prenne de plus en plus d’importance pour que nous mettions en commun notre recherche en matière d’alternative aux phytosanitaires ou d’évaluation de leurs effets, sur les nouvelles techniques génomiques, fondamentales pour mieux résister à la sécheresse et aux agresseurs. La Pac concerne la vie de chaque citoyen dans l’Union européenne, puisqu’elle est présente dans toutes les assiettes et qu’elle structure les communautés rurales et sculpte nos paysages. La Pac doit être défendue, tout en apportant des évolutions utiles, notamment de simplification.
La structure du budget de la Pac et son montant sont des enjeux importants de cette réforme. Où en sommes-nous ?
Le commissaire à l’Agriculture ne le nie pas, il subit de fortes pressions. Il y a d’abord le remboursement de l’emprunt européen, les dépenses militaires… Et en même temps la réticence des États d’aller chercher des ressources supplémentaires. C’est une vraie quadrature du cercle, mais nous devons la résoudre car souveraineté militaire et souveraineté alimentaire relèvent d’un même combat. En tout état de cause, si la Pac n’a pas un budget à la hauteur des enjeux et de ses ambitions, il est clair qu’il faut s’attendre à ce que les pays et les agriculteurs ne se laissent pas faire. Le budget, ce sont des choix politiques. Nos priorités, ce sont notamment la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire et une meilleure adaptation au changement climatique.
La Pac ne peut pas forcément subventionner tous les dégâts des crises. En revanche, il faut une politique des crises qui aille vers une gestion de la perte de rendement, de la perte de revenus et qui puisse mieux couvrir le risque que prend l’agriculteur lorsqu’il s’engage dans une transition visant à s’adapter au changement climatique. Que nous puissions avoir un outil de réponse. Nous avons le devoir de garantir la sécurité alimentaire de nos populations française et européenne, mais aussi la sécurité sanitaire des consommateurs. Ça veut dire aussi, maintenir une forme de diversité de production. Dans ce domaine, nous avons un point de vigilance majeure sur l’élevage qui décapitalise.
Quelles seraient les conséquences concrètes d’une fusion du deuxième pilier de la Pac avec le budget de la Cohésion ?
Le premier pilier vise le soutien au revenu des agriculteurs quand le deuxième s’attache à l’adaptation, aux transitions et à la modernisation des exploitations. Nous leur demandons beaucoup d’efforts pour s’adapter à des normes environnementales exigeantes. Le budget de la Pac, malgré les amputations historiques en euros constants, aujourd’hui le permet. Mais si demain il est fusionné avec d’autres, cela ne sera plus le cas et il sera raboté de mois en mois au gré des diverses priorités du moment. L’autre point auquel nous sommes extrêmement attachés, c’est le fait qu’il n’y ait pas de renationalisation des crédits de la Pac. Si vous laissez les crédits de la Pac à la main des États, cela signifie qu’il n’y a plus de cause agricole européenne et que chacun fera les choses à sa manière.
Les mesures de simplification proposées par la Commission européenne pourront-elles être mises en œuvre dès 2026 en France ?
En ce qui concerne l’Europe, nous aimerions bien que ces mesures soient appliquées dès l’année prochaine. Le commissaire européen à l’Agriculture est offensif sur ce sujet parce qu’il s’agit d’une demande unanime des vingt-sept pays de l’Union européenne. Simplifier, c’est un acte de confiance. Quand c’est complexe, c’est un signe de défiance qui est donné au monde agricole.
Je note avec une grande satisfaction que le contrôle administratif unique que la France a mis en place est maintenant décliné au niveau européen. Nous avons demandé que la base de calcul de la moyenne olympique soit allongée et nous avons été entendus : les États auront désormais la possibilité d’aller jusqu’à hui ans. Il faut maintenant que tout se décline pour mettre cela en œuvre.
Sur le plan national, la proposition de loi Duplomb-Menonville vient de franchir l’étape de la commission mixte paritaire (CMP). Considérez-vous cela comme une victoire pour les agriculteurs ?
C’est une victoire démocratique pour les agriculteurs qui doit encore se confirmer par le vote. Je salue la responsabilité dont ont fait preuve les parlementaires. Au-delà des divergences, ils ont trouvé un chemin commun autour d’un texte essentiel pour notre agriculture, pour nos agriculteurs. Pour que les entraves au métier d’agriculteur soient véritablement levées, il reste une étape : le vote final. J’en appelle une nouvelle fois à la responsabilité des deux chambres. C’est désormais le regard de toute une profession qui se tourne vers le Parlement. Elle attend des actes, pas des hésitations.
Le texte adopté au Sénat, fruit d’un travail étroit avec mon ministère et celui de la Transition écologique, portait une ambition forte et équilibrée pour l’agriculture. Elle offrait, en complément de la LOA, des réponses économiques ambitieuses, réclamées depuis des années par les agriculteurs. La CMP a retenu une version revue et plus modérée, conformément à la sensibilité de l’Assemblée, abandonnant parfois certains sujets majeurs. J’en prends acte, mais je respecte ce choix : l’essentiel est sauf, et les avancées sont là.
À propos du Mercosur, vous avez récemment déclaré tutoyer une minorité de blocage. Pourquoi est-ce si difficile de convaincre d’autres pays ?
Il y a clairement dans la majorité des pays européens l’idée que les accords de libre-échange sont bons pour l’agriculture. C’est une approche que nous partageons, la France n’est pas protectionniste. Il suffit de se pencher sur la balance commerciale agroalimentaire de l’Union européenne excédentaire de plusieurs dizaines de milliards d’euros.
Le débat sur le projet d’accord avec les pays du Mercosur rejoint à ce titre celui de l’Ukraine. Dans leur immense majorité, les pays européens ont dit que les accords de libre-échange devront être précédés d’une étude d’impact. On importe, quelles conséquences précises cela a sur nos filières ? Deuxième critère, des clauses de sauvegarde robustes comparables à celles qui ont été mises sur les productions ukrainiennes afin qu’elles ne déstabilisent pas nos marchés. Troisièmement, un suivi des accords commerciaux. Est-ce qu’ils tiennent leurs promesses ? Et quatrièmement, une exigence absolue de réciprocité des normes. Ces critères d’exigence, nous ne les avons pas avec ce projet d’accord avec le Mercosur. C’est précisément ce qui pose un problème.
Parce qu’ils partagent aussi de vives préoccupations vis-à-vis de ce projet d’accord, des pays comme la Pologne, la Hongrie, l’Autriche, les Pays-Bas, la Roumanie et l’Irlande ou la Belgique s’interrogent sur leur réponse à la proposition de la Commission. L’Italie fait preuve d’une réserve croissante. Certains pays pourraient s’abstenir lors d’un éventuel vote. C’est autant de voix qui n’iront pas en faveur du projet d’accord et cela empêche son adoption à la majorité qualifiée (qui nécessite de réunir 65 % de la population européenne).
C’est une course contre la montre. En plus de l’action des politiques, il faut que les agriculteurs des différents pays de l’Union européenne disent à leurs dirigeants politiques qu’ils refusent ce projet d’accord, tel qu’il a été négocié à Montevideo. Je trouve qu’il y a un déficit démocratique autour de ce projet. Les négociations se sont faites dans l’opacité. Y a-t-on associé les agriculteurs ? Y a-t-on suffisamment associé les États ? À l’évidence, non.
>> Lire l’interview sur LaFranceAgricole.fr
L’article Annie Genevard : « La Pac doit être défendue, tout en apportant des évolutions utiles » est apparu en premier sur les Républicains.